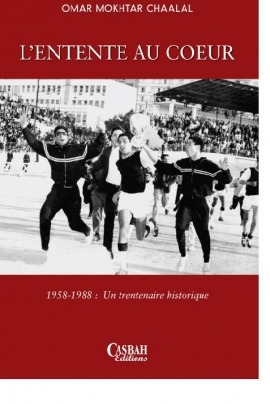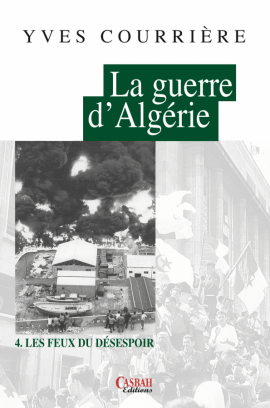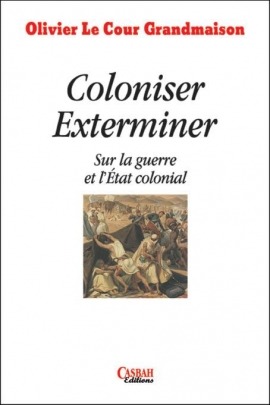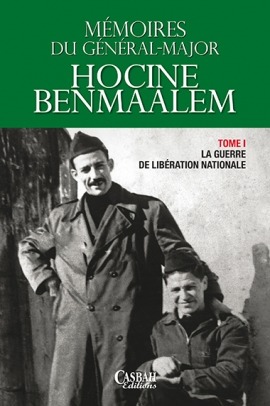Affichage de 289–300 sur 552 résultatsTrié par popularité
L’Entente au coeur – Omar Mokhtar Chaalal
Est évoqué dans ce récit le vibrant hommage à l’engagement plénier et sincère des Anciens, dirigeants et joueurs, qui ont porté l’Entente sur les fonts baptismaux. On garde encore l’impérissable souvenir du virevoltant Mattem, du Brésilien Messaoudi, du métronome Salhi, du buteur Koussim, de l’élégant Bourouba, du relayeur Kharchi, de l’instinctif Khemicha, de l’ondoyant Zorgane et du percutant Adjissa. D’une génération à l’autre, le cap d’homme est brillamment maintenu. Ce qui reste durablement dans le coeur, c’est cette profonde humilité, restituée dans son esprit par l’auteur, qui distingue les joueurs de l’Entente issus des Q’atças, véritable école de football mais plus fondamentalement de la vie où les valeurs d’abnégation, de fraternité, de solidarité et de fair-play ont trouvé leur heureuse expression.
Une vie pour l’Algérie – Abdennour Chikh
Entré en résistance contre le colonialisme, comme maquisard, dès le début de l’année 1948, Amar Ath Chikh a été l’un des organisateurs du 1er Novembre 1954. Militant exemplaire, intègre, courageux et dénué de toute ambition personnelle, il contribua, par ses qualités morales et son abnégation, à approfondir la prise de conscience du fait national.C’est ainsi qu’il réussit à fédérer plusieurs actions politiques. On lui confia dès les premiers mois de la lutte armée, le commandement de la Zone VI dans la future Wilaya III.
En cette période du cinquantenaire de l’Indépendance de notre pays, cet ouvrage apporte un témoignage des proches parents de Amar Ath Chikh et constitue une modeste contribution à la connaissance de l’histoire des moudjahidine de l’Algérie combattante.
Les faits sont relatés avec la plus grande fidélité possible.
La guerre d’Algérie – Volume 4 Les feux du désespoir – Yves Courrière
Volume 4 : Les feux du désespoir
1960: Appel du général de Gaulle au GPRA pour un cessez-le-feu. Echec de « la paix des braves ». 28 mars 1961, le GPRA confirme qu'il enverra une délégation à Evian. 26 avril, échec aux généraux putschistes d'Alger. Bien avant la proclamation du cessez-le-feu du 19 mars 1962, l’OAS met en æuvre sa politique de la terre brûlée.
Massinissa, le grand Africain – Houaria Kadra-Hadjadi
Massinissa (238-148 av. J.-C.), l’un des premiers rois de la Berbérie antique, était le fils d’une prophétesse et de Gaïa, qui régnait sur un modeste royaume, coincé entre le territoire de Carthage à l’est et les États du puissant Syphax, à l’ouest. Animé d’une immense ambition, doué de qualités exceptionnelles, le prince parvint à agrandir le royaume ancestral aux dimensions du Maghreb.
Le contexte politique et militaire de l’époque favorisa cette ascension. Carthage, grande puissance maritime et commerciale, dominait le bassin occidental de la Méditerranée; elle se heurta à l’impérialisme naissant de Rome, au cours de trois guerres dites puniques. Le fils de Gaïa participa à la seconde (218-201 av. J.-C.) déclenchée par Hannibal, génie militaire qui voulait rendre à sa patrie, Carthage, son honneur et sa suprématie. Au terme d’une guerre-éclair, Hannibal remporta quatre brillantes victoires qui mirent Rome à deux doigts de la capitulation. Massinissa se battit d’abord dans les rangs carthaginois en Espagne. Puis, sentant le vent tourner, il rejoignit l’armée romaine commandée par Publius Scipion, le futur Africain. Dès lors, il devint le favori de la Fortune, qui lui accorda pouvoir, gloire et la faveur des Romains.
Comblé par la Fortune de son vivant, il accéda à l’immortalité dès sa mort : ses sujets le divinisèrent et lui élevèrent des temples pour lui rendre un culte. Plus de deux siècles plus tard, il revivra dans l’épopée de Silius Italicus, La Guerre punique, sous les traits d’un guerrier valeureux et énergique, et d’un entraîneur d’hommes aux éminentes qualités morales. À notre époque, Massinissa, le conquérant et le bâtisseur de la grande Numidie, demeure une figure emblématique de l’Histoire du Maghreb.
Coloniser exterminer – Olivier Le Cour Grandmaison
Quelles furent les spécificités des conflits coloniaux engagés par la France en Afrique du Nord et ailleurs ? Que nous apprennent les méthodes singulières –enfumades, massacres de prisonniers et de civils, razzias, destructions de cultures et de villages – couramment employées par les militaires français sur la nature de la guerre conduite pour pacifier l'ancienne régence d'Alger ? Pourquoi de nombreuses mesures racistes et discriminatoires ont-elles été élaborées puis appliquées au cours de la conquête et de la colonisation de l'Algérie ? Comment furent-elles codifiées sous la troisième République puis étendues aux nouveaux territoires de l'empire tels que l'Indochine, la Nouvelle-Calédonie et l'Afrique Occidentale française ? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles cet ouvrage entend répondre.
En effet, la conquête puis la colonisation difficiles et meurtrières de l'Algérie doivent être considérées comme une sorte de vaste laboratoire au sein duquel des concepts – ceux de « races inférieures », de « vie sans valeur » et d'« espace vital », promis à l'avenir et aux usages que l'on sait –furent forgés. De même, on découvre les origines de nouvelles techniques répressives – l'internement administratif et la responsabilité collective notamment – qui, avec le Code de l'indigénat adopté en 1881, firent de l'état colonial un état d'exception permanent. Plus tard, l'internement fut même importé en métropole pour s'appliquer, à la fin des années 1930, aux étrangers d'abord, aux communistes ensuite puis aux Juifs après l'arrivée de Pétain au pouvoir.
S'appuyant sur quantité de documents peu connus voire oubliés, sur la littérature aussi, cette étude originale et dédisciplinarisée éclaire d'un jour nouveau les particularités du dernier conflit qui s'est déroulé entre 1954 et 1962, mais aussi les violences extrêmes et les guerres totales qui ont ravagé le vieux continent au cours du XXe siècle.
Mémoires du Général-major Hocine Benmaalem – Hocine Benmaalem
TOME I : LA GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE
Dans le présent ouvrage, j’évoque des événements importants que j’ai personnellement vécus, en m’imposant une exigence d’objectivité et d’impartialité. J’ai fait appel en grande partie à ma mémoire, mais, pour préciser certains faits, j’ai également consulté des ouvrages ou questionné d’anciens compagnons.
[…] J’ai vécu pendant cette grande et exceptionnelle Révolution une période extraordinaire de ma vie. J’ai eu la chance de servir auprès d’un grand chef révolutionnaire de notre guerre de libération, le colonel Amirouche ; le souvenir de la période que j’ai passée à ses côtés ne s’effacera jamais de ma mémoire.
[…] La vie au maquis était très difficile, mais à aucun moment je n’ai regretté mon choix.
Extraits de l’avant-propos
La guerre d’Algérie – Volume 3 : L’heure des colonels – Yves Courrière
Volume 3 : L'heure des colonels
1958 : La guerre prend une autre tournure avec les événements du 13 mai, les grandes opérations sur le terrain, les zones interdites et les barrages électrifiés aux frontières est et ouest de l’Algérie. 1960, Massu rappelé à Paris. Barricades à Alger, les partisans de l'Algérie française annoncent leur volonté de s'opposer à l'autodétermination annoncée par le général de Gaulle.
Mémoires d’un algérien – Tome 3 : Un dessein inabouti (1979-1988) – Ahmed Taleb-Ibrahimi
Dans ce troisième tome, le lecteur trouvera un aperçu sur la période suivante, sous la présidence de Chadli Bendjedid (janvier 1979-novembre 1988). Fidèle à la méthode khaldounienne, je livre un témoignage événementiel sur les années 80 du siècle dernier tout en essayant d'en tirer des enseignements pour la période
actuelle. Durant trois ans et demi, comme ministre-conseiller, je me suis échiné auprès d'un président qui a pris à coeur une fonction où le moindre faux-pas risque de coûter cher. Durant les six années et demie qui ont suivi, comme ministre des Affaires étrangères, j'ai fait en sorte que mes paroles et mes actes fassent honneur à mon pays.
Le lecteur découvrira sans doute qu'au terme d'une décennie, l'auteur éprouve un certain désenchantement : dès lors que le rêve s'évanouit et la passion s'émousse, que les repères s'estompent et les compères décampent, le coeur n'y est plus. Alors surgit le désenchantement qui vous saisit et vous submerge. Alors il faut savoir quitter la scène... Ainsi, à l'âge de cinquante-six ans, j'ai pris congé sans abandonner pour autant le combat politique. Ce sera, si Dieu le permet, l'objet du tome IV de ces Mémoires qui couvrira la période allant de novembre
1988 à avril 2004.
Extrait de la préface
La guerre d’Algérie – Volume 2 : Le temps des léopards – Yves Courrière
Volume 2 : Le temps des léopards
1955 : Soustelle débarque en Algérie pour y créer une hypothétique troisième force qui aurait pu, selon les libéraux, assurer l'intégration. Il crée les SAS pour reconquérir le “bled” mais échoue dans sa tentative d'isoler le FLN de la population algérienne.
1957 : La bataille d'Alger commence avec la grève des huit jours. Les “léopards” investissent la Casbah mais ne pourront pas juguler la guérilla urbaine..
La police parisienne et les Algériens (1944-1962) – Emmanuel Blanchard
Le « problème nord-africain » : c'est ainsi que la police a pris pour habitude de qualifier après-guerre la question des Algériens installés en région parisienne. Théoriquement égaux en droit avec les autres citoyens français, ils étaient cantonnés à certains emplois et quartiers, en butte à une forte emprise policière et objets de nombreux fantasmes touchant à leurs pratiques sexuelles ou délinquantes.
De 1925 à 1945, les Algériens ont été « suivis » par une équipe spécialisée, la Brigade nord-africaine de la préfecture de police. Celle-ci dissoute, les « indigènes » devenus « Français musulmans d'Algérie » sont désormais l'affaire de tous les personnels de police. Au début des années 1950, l'émeute algérienne devient un sujet de préoccupation majeur, exacerbé par la répression féroce de la manifestation du 14 juillet 1953, place de la Nation. Une nouvelle police spécialisée est alors reconstituée avec la Brigade des agressions et violences. Ses objectifs : pénétrer les « milieux nord-africains » et ficher les Algériens.
Entre 1958 et 1962, dans le contexte de la guerre ouverte en Algérie, le répertoire policier se radicalise : il faut désormais « éliminer les indésirables ». Rafles, camps d'internement et retours forcés se multiplient. Les brutalités policières deviennent fréquentes, jusqu'à la torture. Le préfet de police Maurice Papon reçoit un « chèque en blanc » pour combattre le Fln. Les massacres d'octobre 1961 incarnent le moment le plus tragique de cette période noire. Les mécanismes en sont éclairés par une étude historique rigoureuse fondée sur des archives et des témoignages inédits.
Emmanuel Blanchard est maître de conférences en science politique à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (Cesdip). Ses recherches portent sur les polices en situation coloniale et sur la sociohistoire des politiques d'immigration.
La guerre d’Algérie – Volume 1 : Les Fils de la Toussaint – Yves Courrière
Volume 1 : Les Fils de la Toussaint
1954 : La situation politique est propice au déclenchement d'une insurrection généralisée visant à arracher à la France l'indépendance de l’Algérie. Pourtant, les actions déclenchées dans la nuit du 31 octobre au ser novembre 1954 surprennent le gouvernement français qui prend immédiatement les mesures destinées à rétablir l'ordre.
AU NOM DE LA CIVILISATION, Crimes de guerre et contre l’humanité en Algérie de 1830 à 1962 – Mohamed Sekkal
Comble de l'aberration, les massacres, enfumades et autres actes d'une barbarie indicible sont portés à l'actif de l'oeuvre civilisatrice menée par l'Occident !
Pourtant, en 1847, Alexis de Tocqueville avait tiré la sonnette d'alarme: « Nous avons réduit les établissements charitables, laissé tomber les écoles, dispersé les séminaires, écrivait-il. Autour de nous les lumières se sont éteintes, le recrutement des hommes de religion et des hommes de loi a cessé, c'est-à-dire que nous avons rendu la société musulmane plus misérable, plus désordonnée, plus ignorante et plus barbare qu'elle n'était avant de nous connaître. »